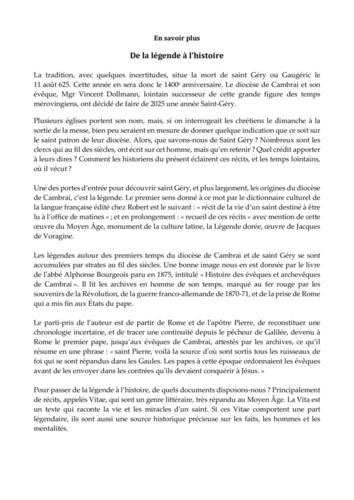En savoir plus
De la légende à l’histoire
La tradition, avec quelques incertitudes, situe la mort de saint Géry ou Gaugéric le 11 août 625. Cette année en sera donc le 1400e anniversaire. Le diocèse de Cambrai et son évêque, Mgr Vincent Dollmann, lointain successeur de cette grande figure des temps mérovingiens, ont décidé de faire de 2025 une année Saint-Géry.
Plusieurs églises portent son nom, mais, si on interrogeait les chrétiens le dimanche à la sortie de la messe, bien peu seraient en mesure de donner quelque indication que ce soit sur le saint patron de leur diocèse. Alors, que savons-nous de Saint Géry ? Nombreux sont les clercs qui au fil des siècles, ont écrit sur cet homme, mais qu’en retenir ? Quel crédit apporter à leurs dires ? Comment les historiens du présent éclairent ces récits, et les temps lointains, où il vécut ?
Une des portes d’entrée pour découvrir saint Géry, et plus largement, les origines du diocèse de Cambrai, c’est la légende. Le premier sens donné à ce mot par le dictionnaire culturel de la langue française édité chez Robert est le suivant : « récit de la vie d’un saint destiné à être lu à l’office de matines » ; et en prolongement : « recueil de ces récits » avec mention de cette œuvre du Moyen Âge, monument de la culture latine, la Légende dorée, œuvre de Jacques de Voragine.
Les légendes autour des premiers temps du diocèse de Cambrai et de saint Géry se sont accumulées par strates au fil des siècles. Une bonne image nous en est donnée par le livre de l’abbé Alphonse Bourgeois paru en 1875, intitulé « Histoire des évêques et archevêques de Cambrai ». Il lit les archives en homme de son temps, marqué au fer rouge par les souvenirs de la Révolution, de la guerre franco-allemande de 1870-71, et de la prise de Rome qui a mis fin aux États du pape.
Le parti-pris de l’auteur est de partir de Rome et de l’apôtre Pierre, de reconstituer une chronologie incertaine, et de tracer une continuité depuis le pêcheur de Galilée, devenu à Rome le premier pape, jusqu’aux évêques de Cambrai, attestés par les archives, ce qu’il résume en une phrase : « saint Pierre, voilà la source d’où sont sortis tous les ruisseaux de foi qui se sont répandus dans les Gaules. Les papes à cette époque ordonnaient les évêques avant de les envoyer dans les contrées qu’ils devaient conquérir à Jésus. »
Pour passer de la légende à l’histoire, de quels documents disposons-nous ? Principalement de récits, appelés Vitae, qui sont un genre littéraire, très répandu au Moyen Âge. La Vita est un texte qui raconte la vie et les miracles d’un saint. Si ces Vitae comportent une part légendaire, ils sont aussi une source historique précieuse sur les faits, les hommes et les mentalités.
L’évêque Athanase d’Alexandrie écrivit au IVe siècle une vie d’un moine du désert Saint Antoine, texte qui a eu une importance considérable dans l’histoire du christianisme. Il fut le premier d’une très longue série de vie de saints. Parcourir ces nombreuses Vitae, nous montre une sainteté en évolution au fil du temps. Le saint est d’abord un martyr tué pour sa foi, puis un confesseur qui témoigne en se retirant du monde par une vie d’ascèse et de prière. Enfin, le saint est un homme ou une femme, actifs au sein du peuple chrétien, abbé, évêque, roi… C’est à cette troisième catégorie qu’appartiennent ces trois Vita Gaugerici.
Le plus ancien est écrit dès le VIIe siècle. Rédigée en latin, on lui donne le nom de Vita Gaugerici ou Vita prima. C’est un document précieux, car c’est une des rares vies de saints écrites durant la période mérovingienne qui nous soit parvenue. La plupart nous sont connues à travers des réécritures carolingiennes ou plus tardives encore. Ce qui atteste son ancienneté, c’est la langue latine utilisée qui présente des caractéristiques mérovingiennes ; l’utilisation d’un vocabulaire propre aux institutions de ce temps : maior domus, comes, iudex, tribunus ; et la description de la procédure suivie lors d’une élection épiscopale conforme à ce qui est prescrit à la fin du VIIe siècle : petitio du clergé et du peuple de Cambrai à Childebert, litterae adressées par le roi au métropolitain de Reims, Égidius, et enfin cérémonie d’ordination à Cambrai présidée par ce même Égidius.